|
by
R.GYSELEN
CNRS, France
L’une
des raisons principales que l’étude du monnayage sassanide est encore
dans un stade peu avancé par rapport à d’autres domaines
numismatiques, est sans aucun doute la non-disponibilité d’une documentation
photographique suffisante pour pouvoir procéder à des investigations
pertinentes. Les publications qui ont fait connaître le monnayage
sassanide, comme par exemple celles d’A. Mordtmann ou d’E. Drouin,
sont peu illustrées. Une illustration plus riche est donnée par
F. Paruck ou J. de Morgan qui ont mis en œuvre d’abord leur
propre collection, et aussi celles des Cabinets des Médailles de
Berlin, Londres, Paris, etc. Mais de ces dernières ne sont
illustrées que quelques exemplaires. Dans ce choix, c’est la ”belle
monnaie” qui a été privilégiée, celle qui fait la joie des collectionneurs,
et les auteurs n’ont pas toujours cherché à mettre en évidence
la variété stylistique du monnayage sassanide qui est pourtant bien
présente dans la plupart de ces collections. Quoiqu’il en soit,
les numismates contemporains continuent d’utiliser ces ouvrages
à défaut de publications plus exhaustives.
Quand R. Göbl a commencé, dans les années 1950, à s’intéresser
à la numismatique sassanide il a été confronté à cette
lacune dans la documentation qui empêchait de faire évoluer
la numismatique sassanide vers un niveau égal à celui atteint
par la numismatique grecque ou romaine, et a été l’instigateur de
plusieurs initiatives pour y remédier. On lui doit la mise en place
d’un fichier à l’Institut de Numismatique de l’Université
de Vienne (= numismatische Zentralkartei) dans lequel ont été intégrées
les photographies et descriptions de très nombreuses monnaies.
Elles font partie des grandes collections publiques déjà
citées et de collections privées, principalement autrichiennes.
On y trouve aussi beaucoup de monnaies publiées dans les catalogues
de vente. Cette entreprise étant bien antérieure aux moyens modernes
de communication électronique, on ne peut consulter ce fichier que
sur place à Vienne. Évidemment, il ne comporte pas l’ensemble
des monnaies de chaque collection publique. Matériellement un tel
enregistrement photographique aurait exigé plus de forces humaines
et de moyens qu’il était possible d’envisager. En outre, un tel
inventaire exhaustif n’était probablement pas non plus l’objectif
de R. Göbl qui cherchait surtout à disposer d’une grande
variété de monnaies pour procéder ensuite à sa typologie
du monnayage sassanide (Sasanian Numismatics, 1971 avec une
version antérieure en allemand) qui sert encore aujourd’hui de référence
à tout numismate occidental. Sans aucun doute, R. Göbl avait
réfléchi à la nécessité de publier exhaustivement les collections.
Il l’a montré en publiant les monnaies sassanides conservées au
Cabinet des Médailles à la Haye, maintenant à Leyde
(1962), initiative qui a été poursuivie, mais toujours pour des
collections relativement modestes, par B. Kapossy (le musée historique
de Berne, 1969-1970) et plus récemment par A. Nikitin (le musée
des Beaux-Arts de Moscou, 1995).
On aurait pu espérer qu’un autre type de publication - celle de monnaies
provenant des fouilles - apporterait une documentation photographique
bien plus complète. C’est souvent le cas pour les trouvailles
isolées, mais rarement pour les trésors monétaires d’une certaine
ampleur. On peut reprocher aux auteurs d’avoir accepté une telle
restriction dans le nombre des illustrations, mais il n’est souvent
guère possible d’outrepasser les exigences des instances
éditoriales. Leur attitude ne s’explique pas seulement par la volonté,
ou la nécessité, d’économie, mais aussi par l’intérêt très
mitigé que le monnayage sassanide suscite. Malgré la demande appuyée
des auteurs, il est rare de se voir attribuer suffisamment d’espace
pour pouvoir illustrer l’ensemble des monnaies qui sont décrites
dans une publication. Il en résulte que d’autres numismates sont
réduits à se contenter des données fournies par le texte.
Cependant, celui-ci ne peut communiquer une image complète
de la monnaie surtout parce qu’aucune typologie monétaire et stylistique
suffisamment détaillée n’existe pour servir de tableau de références.
On se trouve ainsi dans un système de cercle vicieux :
sans documentation photographique importante il est impossible d’établir
une typologie stylistique, et sans cette dernière il est
impossible de décrire une monnaie de façon suffisamment précise
pour qu’elle puisse servir à d’autres études. C’est sans
aucun doute la raison pour laquelle certains types d’études, comme
celles de l’identification des ateliers monétaires de l’époque sassanide
tardive, ou de la métrologie monétaire, ont été plus prépondérantes
que d’autres.
Jusqu’à présent, la documentation la plus riche se trouve souvent
dans des contributions qui traitent d’un problème spécifique.
L’exemple par excellence est le monnayage de Shapur II traité par
R. Göbl dans le cadre du monnayage kouchan, ou encore l’identification
des ateliers monétaires abordée par M. Mochiri dans plusieurs ouvrages
et articles. Le dernier a puisé dans sa riche collection personnelle,
tandis que le premier a mis en œuvre le fichier numismatique
de Vienne. Pour un jeune numismate qui ne dispose ni de l’un ni
de l’autre, il n’est pas aisé d’aborder le monnayage sassanide et
de produire de nouvelles études pourtant indispensables à
l’avancement des connaissances de la numismatique sassanide et de
sa place dans l’histoire de l’empire sassanide.
Pour sortir de cette impasse, le seul moyen est la publication intégrale
des grandes collections publiques et privées dans laquelle chaque
monnaie serait illustrée. Depuis la fin des années 1980, Raoul Curiel
avait suggéré de produire une telle ”sylloge” des monnaies sassanides
dans les collections du Cabinet des Médailles de Paris. Un concours
de circonstances a entravé cette initiative. En 1994, une nouvelle
impulsion, cette fois-ci sur un niveau européen, a connu un peu
plus de réceptivité et a abouti au projet de la ”Sylloge Nummorum
Sasanidorum” dont l’objectif est de publier les collections des
Cabinets des Médailles de Berlin, Bruxelles, Paris et Vienne. Toutefois,
il a semblé indispensable de joindre à la ”sylloge” proprement
dite, une étude stylistique du monnayage sassanide, sujet qui, à
l’exception d’une ébauche restreinte par I. Pfeiler, n’a pas été
traité auparavant et qui représente une des bases indispensables
pour des études numismatiques ultérieures. Née avant l’accès
facile aux réseaux électroniques, ce travail sera publié sous la
forme traditionnelle d’un ouvrage.
Depuis quelques années, des initiatives de plus en plus nombreuses ont
vu le jour pour mettre à la disposition des numismates des
séries monétaires sur un support électronique. Jusqu’à présent
aucune collection n’a été intégralement rendue publique de cette
façon et le catalogue de Vlastimil P. Novak et J. Militky est le
premier qui traite d’un ensemble bien circonscrit. L’idée de réunir
dans un même catalogue toutes les monnaies sassanides conservées
dans les collections publiques et privées tchèques ne peut
que recevoir un accueil favorable. Sans le travail d’investigation
d’un numismate résidant sur place, il est certain que bon nombre
de ces monnaies n’auraient jamais été connues par les numismates.
Le fait de présenter un catalogue sur support électronique à
consulter sur Internet, ne change rien à l’exigence scientifique
de la contribution. Comme pour une publication traditionnelle, l’important
est la qualité de l’image, l’exactitude de la description, la richesse
des données et la présence d’index. Tous ces aspects ont été respectés
dans le catalogue électronique que V. P. Novak et J. Militky présentent
des monnaies sassanides conservées en Tchéquie. On ne peut que se
réjouir de disposer désormais pour la numismatique sassanide d’un
ensemble documentaire peu connu et qui le serait resté sans la persévérance
de nos collègues numismates tchèques.
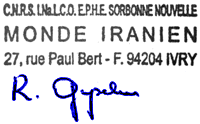
|
![]()
![]()